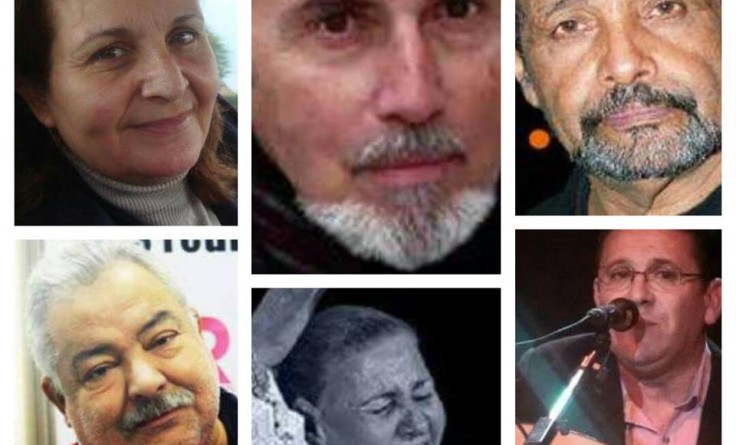Néji Bghouri a été élu, dimanche 19 avril 2014, président du Syndicat national des Journalistes tunisiens. Sept représentants de sa liste « L’Union de la Profession » seront parmi les neuf membres constituant le bureau exécutif dudit syndicat. A Business News, Néji Bghouri a accordé cette interview dans laquelle il revient sur le putsch l’ayant destitué, par le passé, de la présidence du même syndicat, sur sa position quant à la HAICA et sur sa vision de la représentativité d’un secteur en pleine mutation.
La présidence du SNJT, une expérience que vous avez connue et qui s’est terminée d’une manière peu commune. Comment évaluez-vous ce passage assez court par une fonction qui était visiblement très délicate ?
J’avais été élu, en 2008, premier président du Syndicat des journalistes. Il y avait alors beaucoup de problèmes avec les gouvernants. Le conflit avait atteint son paroxysme quand on est venu au SNJT nous proposer de publier un communiqué dans lequel on soutiendrait la représentation de Ben Ali pour les élections de 2014. Dans le bureau élargi, la majorité était favorable et une minorité s’y était opposée. Je faisais partie de cette minorité-là. J’avais alors exercé mon rôle d’une manière non-démocratique et j’avais bien fait de le faire. En réponse à cette requête, j’avais, à l’époque, publié un communiqué dans lequel j’annonçais que nous n’allions pas soutenir Ben Ali, car nous sommes une profession libre et indépendante.
Les choses avaient alors empiré, au point que, peu de temps après, il y a eu un putsch. Le 15 août 2009, exactement, et le bureau entier avait ainsi été destitué. Ce putsch était une suite à cette décision, mais aussi au rapport du 3 mai 2009 dans lequel nous avions fait un bilan pour le secteur et où étaient répertoriées toutes les difficultés qu’il connaissait. On y avait accusé le pouvoir et le clan des Trabelsi d’être une entrave à notre travail en tentant de mettre mainmise sur le secteur (le cas Assabah en était un exemple). Tout ceci avait suscité la colère du pouvoir qui avait décidé, alors, de nous destituer. Une pétition de retrait de confiance avait été lancée, une pression a été faite sur des membres du bureau pour les pousser à démissionner, un congrès extraordinaire avait été tenu et d’autres personnes avaient pris notre place.
Quelles leçons avez-vous tirées de ce bref passage par la présidence du SNJT que vous présidez désormais ?
Le SNJT, je l’ai d’abord intégré en étant jeune journaliste. Dans les vingtaines de mon âge je suis passé par cet enthousiasme par lequel passent certains confrères, en ce moment, dans leur manière de raisonner pour le secteur de la presse. J’avais attrapé le virus du métier de journaliste. J’avais renoncé pour cela à beaucoup de choses importantes et j’ai fait beaucoup de sacrifices. J’ai ainsi appris que s’enthousiasmer ne suffit pas et qu’il faut avoir une vision claire et convaincante. L’expérience est très importante pour la gestion du syndicat des journalistes et celle que j’ai acquise à ce poste m’aidera. Que l’on se trompe, que l’on se soit corrigé, que l’on ait essayé est, en effet, très bénéfique.
Nous devons travailler de telle sorte que les portes s’ouvrent devant nous, le jour où nous sommes contraints de frapper dessus. Le syndicat des journalistes ne peut avancer seul, en étant attaqué de part et d’autre. C’est pourquoi nous devons choisir nos alliés. Nous ne devons pas être en situation de conflit avec les patrons de presse, car on peut avoir à négocier avec eux concernant certains dossiers et il faut privilégier dans ces contextes le consensus aux conflits.
Comment pensez-vous qu’il est possible d’aider le journaliste dans sa lutte quotidienne pour l’information et pour la préservation de ses droits ?
Un journaliste qui peut aspirer à un apport de qualité est un journaliste qui jouit de ses droits, qui est payé décemment et qui travaille dans de bonnes conditions. Les journalistes jouent un rôle important dans la société, ce sont des cadres dans ce pays et ils ont un prestige qui doit refléter la grandeur de ce rôle. Ceci ne peut être fait dans des entreprises en mauvaise santé financière et, dans le bon intérêt des journalistes, les entreprises médiatiques doivent être florissantes. Je suis pour que l’on soutienne les entreprises pour l’obtention de la publicité publique, mais j’exige que celles-ci s’engagent à améliorer la situation des journalistes selon certaines conventions.
Je n’irai pas jusqu’à exiger que les revenus de la publicité soient partagés en partie avec les journalistes. Mais je pense que des parties de revenus pourraient être versées à des caisses de solidarité qui seront utilisées en cas de besoin par des journalistes en difficulté. Certains journalistes vivent, en effet, dans une situation de précarité extrême, n’arrivant même pas à se soigner en cas de besoin, en l’absence d’une couverture sociale. C’est pourquoi la solidarité doit être de rigueur entre les différents corps de métier. Sans renoncer à nos droits et à notre indépendance, nous devons œuvrer pour le bien du secteur en collaboration avec ses différents acteurs.
Comment voyez-vous le travail du SNJT dans l’avenir ?
La liberté de la presse pour laquelle nous bataillons quotidiennement, n’est pas un acquis qui profite aux journalistes uniquement. C’est un droit et non un luxe, un atout vital pour notre secteur et qui profite à toute la société. S’il n’y a pas de liberté de presse, le politicien ne peut pas faire parvenir son message d’une manière correcte. Le journalisme est, en effet, l’espace réel où se concrétise la réalité politique. La société civile doit donc percevoir l’importance du soutien qu’elle doit apporter au SNJT dans sa lutte pour la défense de la liberté de la presse et pour sa garantie dans notre pays.
Beaucoup de candidats ont évoqué l’évolution du syndicat vers une union des journalistes. Une telle ambition passe par une loi afin que les journalistes aient un droit de regard sur la profession et sur l’accès à elle, à travers notamment l’octroi des cartes de presse et la publicité. Comment aspirer à faire passer un projet aussi ambitieux comme l’union nationale des journalistes, sans qu’il n’y ait de consensus avec les patrons de presse qui auraient compris au préalable que leur intérêt est d’être de notre côté? Sans un syndicat fort et bénéficiant d’une bonne réputation auprès de la société civile, comment pouvons-nous mettre en place un lobbying pour faire passer, aux yeux de l’Assemblée nationale, une loi aussi importante pour le secteur? Oui, nous sommes tous d’accord pour le diagnostic que l’on fait pour le secteur. Oui, le syndicat est affaibli, oui le syndicat a fait perdre des opportunités aux journalistes, oui la situation du secteur est très fragile, oui la liberté d’expression est menacée, en attestent les attaques qu’a subies le secteur sous les gouvernements Laârayedh et Jebali. Cela relève d’un constat des faits, d’un diagnostic autour duquel nous sommes unanimes, mais quelles sont les solutions ? A mon avis, sans un bureau syndical fort et mûr, un bureau où chaque action est bien étudiée, nous n’y arriverons pas.
Vous aviez été membre de l’Instance nationale de régulation de l’Information et de la Communication. Comment évaluez-vous cette expérience et le rendement de cette instance ?
Le 18 janvier, soit quatre jour après le départ de Ben Ali, près de 200 journalistes se sont réunis au SNJT et ont réclamé le retour du bureau exécutif que je présidais. J’avais alors repris les commandes d’une manière officieuse avec un message clair : je suis contre la chasse aux sorcières. J’ai entière connaissance de l’oppression qu’ont connue certains collègues, je sais que le pouvoir savait comment dompter certains d’entre eux. L’essentiel, selon moi, à ce moment-là, était de prouver, dans la période qui suivait, que l’on était libre et qu’on ne se soumettrai plus devant personne. J’avais, alors, été contacté par le gouvernement Ghannouchi, aux commandes du pays à l’époque, pour réfléchir à des solutions pour le secteur. Certains futurs ministres m’avaient interrogé quant à l’intérêt d’avoir un ministère ou un secrétariat d’Etat de l’Information. Nous avions exprimé notre refus des deux alternatives car nous sommes, foncièrement, opposés à la soumission du secteur au pouvoir exécutif, le journalisme étant lui-même un pouvoir et non des moindres.
A l’époque, nous avions débattu aussi avec certains partis de l’opposition comme le PDP et Ettajdid et nous les avions convaincus de notre position. A mon avis, cette décision de refuser la mise en place d’un ministère en charge de l’Information était un pas important pour le secteur.
Comme alternative, nous avions proposé une instance indépendante. Celle-ci avait été mise en place, mais avec beaucoup de précipitation. Ses lacunes ont été une des raisons pour lesquelles je l’ai quittée après y avoir été membre. Mais je pense, tout de même, que l’INRIC a fait un bon travail en préparant, à travers l’article 116, la mise en place de la HAICA.
Aujourd’hui, la HAICA existe. Les cahiers de charge qu’elle a mis en place ont été publiés dans le JORT et beaucoup critiquent sa manière de faire. Quel regard portez-vous sur cette instance de régulation très contestée par les gens du métier?
J’estime qu’il est mieux d’avoir une instance indépendante comme la HAICA pour réguler le secteur, plutôt qu’un ministère. Si nous dépendions d’un ministère, précisément sous les gouvernements Laârayedh ou Jebali, ça aurait été une catastrophe pour la presse tunisienne. Que nous ne soyons pas dépendants du pouvoir exécutif, que nous dépendions d’une instance indépendante est donc bénéfique, quelles que soient les réserves que j’ai concernant les travaux de cette instance. Je sais que les propriétaires de chaînes de radio ne sont pas satisfaits quant aux cahiers des charges mis en place par la HAICA et je pense qu’ils ont le droit d’émettre leurs avis. J’estime qu’un dialogue aurait dû être lancé avec les parties concernées avant la publication desdits cahiers des charges dans le journal officiel. Un compromis aurait pu être trouvé pour que tous soient satisfaits. Notre but n’est pas de changer une force répressive par une autre.
L’instance de régulation telle que la HAICA est apte, à mon sens, à préserver la presse de certaines pratiques qui sont susceptibles de mettre à mal les valeurs de l’Etat en relation avec les droits de l’Homme, avec les statuts de la femme, de l’enfance. Notre secteur, nous devons le préserver de l’argent politique, de l’oppression, de l’intimidation, des abus qui viendraient du pouvoir exécutif et des dérives de certaines milices. Le pouvoir est en passe de changer de main et nous devons donc travailler pour rester à l’abri de toute immixtion de sa part dans notre travail. La bataille pour une presse libre et sans pression n’est donc pas finie et nous devons la mener ensemble, la HAICA, comme les patrons de presse. La HAICA doit, de ce fait, travailler en harmonie avec les différentes parties. Son poids n’en serait que plus grand et son pouvoir de régulation plus efficace.
Vous représentez désormais les journalistes tunisiens, mais la représentativité totale existe-t-elle, dans un secteur qui a épousé, par la création de certains médias au contenu bien orienté, les mouvances politiques et idéologiques ?
Oui, il y a de nouveaux titres et beaucoup de nouveaux médias qui naissent. Leurs orientations sont différentes et je trouve que cela est à percevoir comme un avantage. Un de nos objectifs est d’avoir un secteur varié et prospère. Je trouve, par ailleurs, qu’il n’y a aucun problème à ce qu’un organe de presse ait une tendance quelconque, qu’il soit de gauche ou de droite. Partout dans le monde, il y a de telles divergences dans le traitement de la matière. Le lecteur, comme l’auditeur ou le téléspectateur, peuvent trouver ce qui les intéresse dans cette variété, mieux que dans un contenu uniforme. A une époque, on avait peur de ces différences. Nous devons désormais les considérer comme un moyen d’enrichissement, un potentiel de construction et non de destruction. Cependant, des normes devraient être mises en place, car, même dans un pays démocratique où la liberté est déjà acquise, il y a une règle à respecter, c’est le travail pour un journalisme de qualité. Que le média soit public ou privé, nous rendons un service au citoyen et ce service est très délicat.
Nous façonnons l’opinion publique, nous fabriquons une culture, il est donc primordial qu’il y ait régulation et surtout autorégulation. Une charte déontologique est une garantie, dans ce sens, d’un lien de confiance avec le lecteur et d’une relation saine au sein d’une même entreprise. Cette pratique, déjà entamée par certains médias, devra se poursuivre, car c’est la première base d’un journalisme de qualité. Nous sommes des intermédiaires entre le pouvoir et le peuple, c’est pour cela que des règles doivent être mises. Mais je veux qu’il n’y ait ni exagération ni abus, car l’instance de régulation ne doit pas se transformer en oppresseur.
L’avenir du secteur journalistique et le rendement à venir de son syndicat, comment les voyez-vous ?
Nous avons constaté, dans la période passée, que des médias ont appelé au djihad, d’autres ont encouragé au meurtre, certains ont motivé la violence et d’autres l’ont justifiée. J’estime, dans ce contexte, que nous devons profiter de la liberté de l’après-Ben Ali, sans pour autant aller vers les dérives de cette liberté.
Notre but à tous est la réforme du secteur pour la mise en place d’un produit journalistique de qualité qui respecte la culture de ce peuple, qui respecte les droits de l’Homme et le civisme atteint par ce pays. Toute prétention mise à part, nous sommes une élite, nous sommes la crème de la société, son intelligentsia et nous devons être le reflet de cette société avec toutes ses diversités et sa richesse d’idées. Nous voulons unifier le secteur car, avant de demander le soutien de nos alliés, nous devons résoudre les problèmes régnant entre nous-mêmes. L’image du journaliste ne peut être façonnée et préservée que par un syndicat ouvert à tous, fort et bénéficiant de l’approbation de tout le secteur.
Consulter la source





 L’artiste ne meurt jamais. Les notes, les paroles, la réflexion qu’il laisse après lui sont la continuité de son être et de sa manière d’être. Son corps ne peut que se reposer. Quant à son âme, elle ne s’arrête jamais de vivre…
L’artiste ne meurt jamais. Les notes, les paroles, la réflexion qu’il laisse après lui sont la continuité de son être et de sa manière d’être. Son corps ne peut que se reposer. Quant à son âme, elle ne s’arrête jamais de vivre…